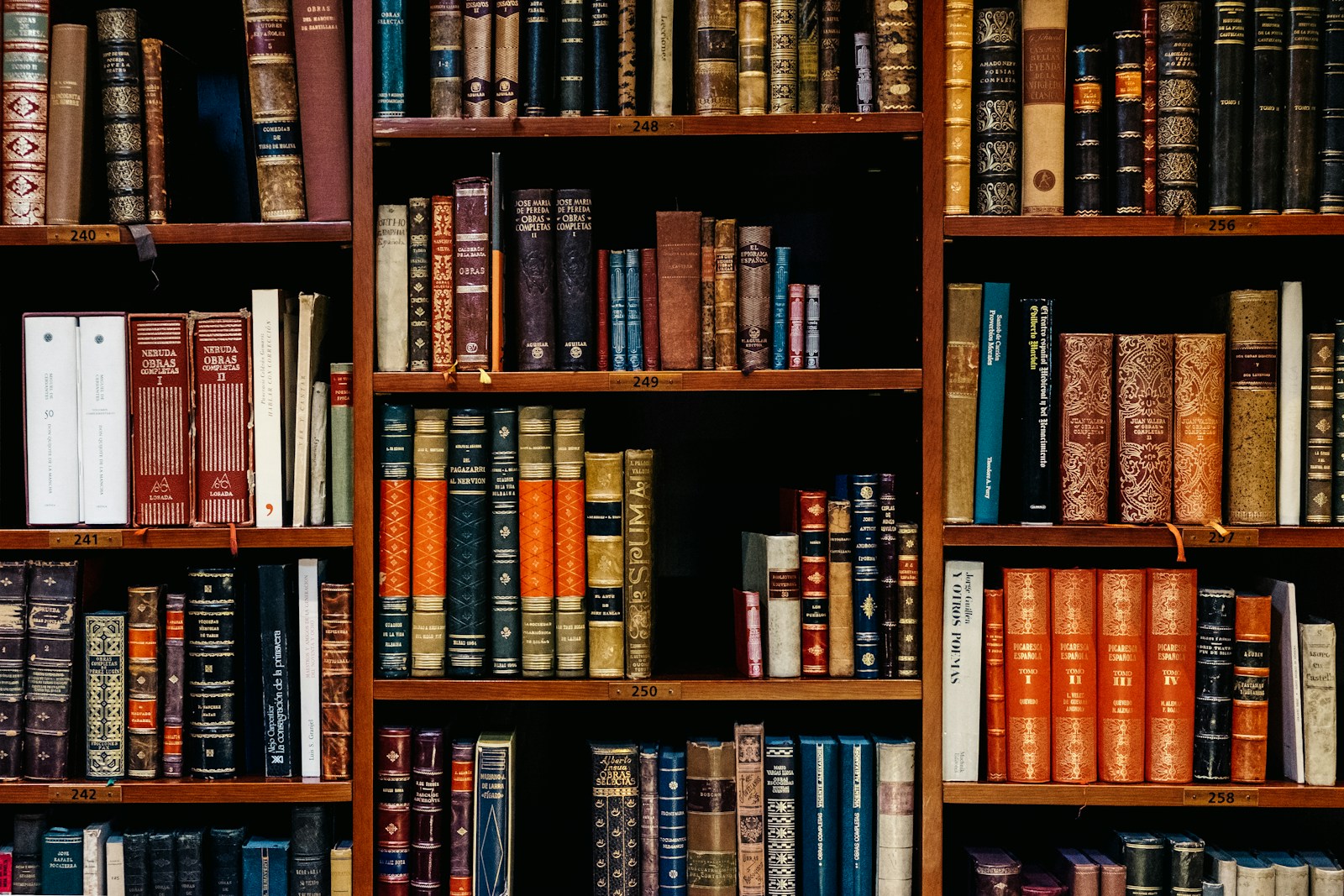De substitution des solvants
Étape 1 : Identification du problème
L’objectif de cette étape est de circonscrire le problème à résoudre.
Cette étape comprend essentiellement l’identification et la discussion du problème à l’origine de l’idée de substitution d’un solvant.
On explicitera les raisons motivant le désir d’éliminer le solvant incriminé : santé, sécurité, environnement, réglementation, coûts, etc.
Une visite de reconnaissance des lieux de travail est effectuée afin de rencontrer les personnes intéressées comme les ingénieurs, les contremaîtres et les travailleurs qui effectuent le travail impliquant le(s) solvant(s) visé(s).
Exemple :
Telle entreprise décide de travailler au remplacement du trichloréthylène (TCE), utilisé comme détachant à tissus dans une fabrique d’étoffes laineuses. Le potentiel cancérigène de ce solvant et des plaintes d’irritation oculaire et d’assèchement cutané chez certains employés ont motivé l’entreprise à travailler à son remplacement.
Étape 2 : Formation d’un comité de substitution
L’objectif de cette étape est d’assurer une assise administrative solide au projet de substitution.
Il s’agit de constituer un comité de substitution et de signer un accord entre l’entreprise et le ou les éventuels organismes externes.
Le comité de substitution est composé au minimum d’un responsable, idéalement technique, de l’entreprise et d’un hygiéniste ou technicien en hygiène industrielle. De plus, l’équipe comprend diverses personnes appelées à s’impliquer de façon ponctuelle comme un contremaître, un délégué des employés, un représentant du service de l’assurance-qualité,
une personne du service des achats ou un spécialiste du service des finances de l’entreprise.
Les objectifs et la démarche du projet de substitution sont clairement présentés dans une courte lettre d’entente à laquelle est annexée la liste des membres du comité de substitution. L’obtention de l’appui ferme de la haute direction de l’entreprise pour la réalisation du projet est essentielle.
Étape 3 : Etude du problème et définition des critères de sélection
Cette étape comprend l’étude détaillée du procédé et des tâches où l’on retrouve le solvant à remplacer.
La littérature technique apporte un complément d’information pour assurer une compréhension optimale dans le cas des procédés complexes.
Le comité de substitution effectue une analyse fonctionnelle du solvant à remplacer, c’est-à-dire se penche notamment sur les raisons de l’utilisation du solvant et sur les procédures de travail. Plusieurs visites sont nécessaires afin d’observer le procédé et les employés à différents moments. Des interviews d’employés peuvent s’avérer nécessaires afin d’obtenir des renseignements non documentés.
Les rapports d’hygiène industrielle pertinents sont étudiés et des mesurages sont effectués au besoin pour documenter les niveaux d’exposition des travailleurs au solvant à remplacer.
Les données quantitatives sur l’utilisation des solvants sont obtenues des services concernés. Cette étape se poursuit par la rédaction d’un texte décrivant le procédé et les méthodes de travail, l’utilisation du solvant et l’exposition des travailleurs.
Les critères de sélection d’un nouveau solvant ou d’un changement de procédé sont également définis par le comité de substitution à la lumière des aspects techniques du procédé, des coûts, du cahier des charges des produits finis, mais également des facteurs sanitaires, sécuritaires et environnementaux.
Étape 4 : Proposition d’options de rechange
L’objectif de cette étape est de faire un inventaire aussi large que possible des solutions envisageables.
C’est la phase des idées faisant appel à un remue-méninges et à une remise en question approfondie. La série d’options, que ce soit des produits de remplacement ou des procédés de substitution, doit être la plus large possible.
Cette étape fait appel à une panoplie de sources d’information et d’outils incluant les nombreuses études de cas.
Plusieurs personnes-ressources sont contactées, notamment le personnel technique de l’entreprise en question et des autres usines affiliées, les travailleurs utilisant les solvants à remplacer, les compétiteurs, les membres d’associations industrielles et les spécialistes chez les fournisseurs de solvants.
Des recherches documentaires sont effectuées dans des bases de données bibliographiques et les banques de données factuelles. Des recherches sur des sites web en santé et en sécurité du travail, mais également en prévention de la pollution sont aussi effectuées. Des groupes de discussion par Internet dans les mêmes domaines sont mis à contribution.
Les options sont ensuite sélectionnées sur la base de critères sécuritaires, sanitaires, environnementaux ou techniques évidents.
Étape 5 : Essais à petite échelle
Lorsqu’une multiplicité d’options a été retenue à l’étape précédente, il peut être nécessaire de procéder à la réduction de leur nombre en procédant à des essais en laboratoire.
Dans certains cas ces derniers peuvent être effectués directement au poste de travail, mais toujours à petite échelle.
Un protocole est élaboré par le comité de substitution en collaboration avec le laboratoire de recherche et développement ou celui du contrôle de la qualité de l’entreprise.
Les essais sont effectués en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter une exposition indue des travailleurs par toutes les voies d’absorption.
Les options sont alors sélectionnées sur la base de leur aptitude à satisfaire les exigences techniques de l’entreprise. En outre, certains paramètres subjectifs comme l’odeur peuvent parfois être jugés primordiaux au moment des essais.
Étape 6 : Évaluation des conséquences des options retenues
L’objectif de cette étape est de documenter les impacts potentiels des options retenues.
Ces dernières sont évaluées en fonction de leurs conséquences sur les facteurs suivants : santé et sécurité du travail, ergonomie, environnement, qualité technique, coûts, méthode de travail, organisation du travail, formation des employés.
Une recherche dans les bases de données bibliographiques et les banques de données factuelles est effectuée pour chacune des solutions envisagées. Par ailleurs, les fiches de données de sécurité, les fiches techniques et autres documents sont obtenus des fournisseurs de solvants et autres produits de remplacement.
Le cas échéant, l’expérience collective d’hygiénistes industriels, d’ingénieurs et de chimistes étrangers est mise à contribution par l’intermédiaire des groupes de discussion dans Internet, spécialisés en santé et sécurité du travail, prévention de la pollution et technologie, pour s’enquérir des problèmes potentiels avec les « nouveaux » solvants ou procédés.
Des visites peuvent être organisées dans des entreprises où le procédé a déjà été mis en œuvre avec succès. Les fournisseurs de solvants peuvent servir d’intermédiaires pour établir ces contacts. Il peut aussi être nécessaire de contacter les clients de l’entreprise afin de discuter de leurs exigences quant au produit fini.
Étape 7 : Comparaison des options et choix
L’objectif de cette étape est de comparer les diverses solutions entre elles et avec la situation originale afin de procéder au choix final.
L’information est synthétisée de façon à faire ressortir les principaux avantages et inconvénients, par exemple sous la forme de tableaux.
La meilleure option est sélectionnée en fonction des critères définis à l’étape no 3 : Étude du problème et définition des critères de sélection.
Étape 8 : Implantation
L’objectif de cette étape est de mettre en œuvre la solution retenue.
L’entreprise sollicite l’appui du fournisseur pour la formation des utilisateurs.
L’implantation est faite de façon graduelle sur un poste de travail puis sur l’ensemble. L’exposition des travailleurs au nouveau produit est mesurée afin de s’assurer de la salubrité du milieu de travail.
La collecte des commentaires techniques sur l’utilisation d’un nouveau produit ou procédé est effectuée systématiquement par les contremaîtres.
Lors de l’implantation, étape essentiellement technique, il faut néanmoins s’assurer de respecter l’ensemble des règles de l’art de l’hygiène et de la sécurité du travail applicables à la nouvelle situation : ventilation, manipulation et stockage, protections respiratoire et cutanée.
Étape 9 : Évaluation
Cette dernière étape doit permettre de mesurer l’atteinte des objectifs de départ et d’apporter des corrections éventuelles.
Un bilan des divers aspects reliés à la nouvelle procédure est rassemblé et comprend notamment la qualité technique, les résultats de mesurage de contaminants nouveaux et le bilan massique des solvants, en comparaison avec la situation antérieure.
La survenue éventuelle de nouveaux problèmes de santé ou de sécurité du travail doit être documentée notamment par une surveillance sanitaire, particulièrement importante en cas d’introduction de nouveaux produits.
Les responsables de l’entreprise doivent être à l’affût de tout nouveau problème environnemental généré par l’utilisation d’un nouveau solvant ou procédé.